Appel à textes: nouvelle n°2, Le bon sens.
Nouvelle découverte aujourd’hui avec notre deuxième sélection dans l’appel à textes “expérimentation libre avec la nouvelle”. Voici Le bon sens, par Christine Guyot.
Mais d’abord je vous laisse découvrir les contraintes, afin que vous puissiez mieux apprécier le travail d’écriture :
Les contraintes:
- Partir de l’expression « avoir du bon sens »
- Insérer dans le texte une liste de 20 mots pris au hasard dans des grilles de mots fléchés : Kilimandjaro, mimosa, paresse, éclos, insolite, isolée, rapatriée, dodu, sirotée, fripée, ocre, duel, biscuit, assassin, pervers, veuve, casserole, investir, oiseau, février.
- A la manière de Guy de Maupassant
- Une nouvelle à chute
Bonne lecture !
LE BON SENS
C’était une de ces jolies veuves, à peine fripée par ses 40 ans, dodue, paresseuse, aimant à se faire servir par un personnel servile et irréprochable. Elle vivait à Paris, près de la Madeleine, à deux pas de la fameuse épicerie fine Hédiard où elle envoyait plusieurs fois par jour sa bonne lui acheter quelques douceurs. Biscuits, tartelettes, brioches, meringues, chocolats, nougats, étaient devenus, au fil des années, sa raison de vivre, son bonheur, sa consolation. Elle les avalait, dévorait, engloutissait, engouffrait sans même prendre le temps de les mâcher, tant son plaisir passait avant son bon sens.
De bon sens, justement, elle n’en avait point hérité. Pourtant, ses parents en avaient à revendre. Elle était la fille unique et chérie de deux petits commerçants laborieux, spécialisés en articles de mercerie-bonneterie, attachés à leur boutique rue Neuve-Saint-Augustin comme un oiseau à son nid. Ces deux petites âmes diligentes et consciencieuses, levées aux aurores, trimant tout le jour parmi les aiguilles, les boutons, les agrafes, les fils, les rubans et autres passementeries, gagnèrent péniblement le petit pécule qui permit à leur fille adulée de se marier à un fabricant de casserole en cuivre, beau comme un Dieu grec et à l’avenir fort prometteur.
Après leur mariage, le couple avait aménagé dans un petit appartement bourgeois du neuvième arrondissement. Au tout début, elle s’enflamma à la vue de ses nouveaux meubles, de sa vaisselle argentée, de ses plafonds hauts aux moulures Régence, de son tapis persan ; puis l’ennui vint, et avec lui la rancœur. Ses meubles lui parurent lourdauds, sa vaisselle n’était en fait qu’une pâle copie de l’argenterie qu’elle aurait désiré posséder et son tapis attirait les mites.
Pourquoi n’avait-elle pas cette vie d’opulence que toutes les parisiennes autour d’elle menaient ? Pourquoi habitait-elle dans ce quartier minable alors que les grandes dames se prélassaient, elles, dans leur hôtel particulier, rue de Varenne ?
Ruminant ses désillusions, dépité par sa vie de petite bourgeoise, son tempérament se gâtait. Elle devenait irascible, emportée, intraitable. Elle fondait en larmes à la moindre contrariété, passait des journées entières à lire des romans dans une chambre où la bonne n’osait plus ouvrir les lourdes tentures de velours ocres, entrait dans des colères noires menaçant la jeune paysanne qui lui servait de cuisinière de lui donner ses gages tant elle était incapable de lui servir nourriture à son goût. Son mari pensa qu’il fallait lui faire un enfant pour la rendre plus joyeuse, mais le sort voulu qu’un garçon naisse, et elle, ne jurait que par une fille.
Que veux-tu que je fasse d’un garçon ? avait-elle reproché à son époux en refusant le poupon juste éclos que l’on voulut lui mettre dans les bras à la naissance. On confia donc l’enfant à une nourrice pour ne point irriter plus la jeune mère. Eperdu, ébranlé, consterné, son mari ne savait à quel saint se vouer pour rendre sa bonne humeur à sa femme. Il tenta l’idée d’un deuxième enfant mais elle lui ferma sa couche sous prétexte qu’elle avait des faiblesses au cœur et qu’il ne lui fallait donc plus aucune contrariété. Ainsi, pas un jour ne passait sans qu’elle ne demandât à la providence une vie de luxe et de magnificence pour laquelle elle en était persuadée, elle était née. Par chance, la providence tendit l’oreille et lorsque ses parents moururent prématurément, rongés par l’anémie et l’épuisement liés à leur condition, elle hérita d’une coquette somme d’argent. Somme, qui fut aussitôt investie par son mari dans l’achat d’une usine à Chatenay Malabry car il avait le grand projet de se lancer dans la fabrication de casseroles émaillées. Aussi insolite que cela puisse paraitre, son nouveau placement prospéra au-delà de ses espérances et il acquit rapidement la fortune qui manquait tant au bonheur de Madame.
On déménagea donc dans le huitième arrondissement, un quartier plus en rapport avec la réussite de Monsieur et Madame ne sirota plus ses breuvages que dans des verres à pied en cristal de Bohême. Rapatriée enfin dans le quartier qui aurait dû être sien depuis son arrivée à Paris, elle mena la vie d’aristocrate dont elle avait toujours rêvé et, pendant quelques années, pas un jour ne se leva sans qu’elle ne savourât sa vertigineuse ascension. Elle exultait, jubilait et surtout dépensait sans compter. Sa garde-robe débordait de soies légères aux transparences de cristal, de robes garnies de dentelles de vieil Alençon, de corsages de satin décolletés très bas. Elle portait des gants de Suède et s’éventait à l’opéra avec des éventails chantilly à monture ivoire. Elle menait grand train, invitant sans compter, organisant des soirées costumées, courtisant ces dames auxquelles elle voulait tant ressembler. Elle se passionna pour les tableaux, voulut en posséder, supplia son mari de lui acheter un Cabanel, se para de bijoux, de soies, de dentelles, fit venir les plus grands traiteurs, embaucha deux cuisinières, une camériste, une chambrière, un maitre d’hôtel qu’elle paya double car il avait travaillé chez la marquise de Merfeuil, prit des cours de maintien, apprit à parler avec la bouche en cul de poule, sermonna son mari qui continuait à poser les coudes sur la table en marqueterie japonaise, exigea qu’il apprenne les règles du whist pour faire partie du club de ces messieurs à haut de forme.
Mais, comme toujours, après quelques années de cette vie de délectation, l’ennui rattrapa son plaisir et elle recommença à avoir des humeurs. Son mari la délaissait, trop occupé par ses fonctions. Son commerce à lui florissait, il plaçait son argent en obligations, traitait avec la compagnie commerciale des Indes et les banques centrales, il alla même jusqu’à investir dans une mine d’argent en Afrique car le bruit courrait dans son club que l’on avait trouvé un filon sur les pentes du Kilimandjaro. Madame quant à elle, saoule de lassitude, suivit les conseils d’une amie bien intentionnée qui l’engageait à prendre un amant pour pimenter sa vie. Elle donna donc la chasse à un jeune noble désargenté, de dix ans son cadet, qui ne résista pas longtemps à ses avances, trop content de trouver chez Madame, le mécène qui manquait à son confort quotidien. Leur idylle fut de courte durée car Madame s’enflammant au-delà de la raison et de la bienséance, embrassa à pleine bouche, et devant témoins, le jeune amant lors d’une soirée à l’opéra, à l’acte II, pendant le solo de Mme Butterfly, et Monsieur, dont la jalousie était notoire, n’eut d’autre alternative que de provoquer en duel le jeune aristocrate. Tous deux se couchèrent dans la rosée du matin, pour ne plus jamais se relever, dans un champ près de St Cloud. Les balles de leurs pistolets respectifs tirées simultanément avaient atteint sans détour le seul organe qui ne supporte aucun intrus : le cœur.
Ainsi donc, éplorée, isolée et veuve Madame se consolait en avalant des montagnes de douceurs sucrées sous les mimosas en fleur de son hôtel particulier. Mais le mois de février plus pervers qu’il n’y parait apporta dans les cuisines parisiennes la casserole en inox qui signa l’arrêt de mort de la casserole émaillée. Désargentée, ruinée, mise à nue par une armée d’huissiers Madame dû céder ses robes, ses tableaux, ses meubles et jusqu’à ses derniers bijoux. Elle réussit tout de même à sauver des griffes des importuns un diamant de plus de dix carats qu’elle avait reçu en cadeau de feu son mari. Drapée dans sa dignité, c’est en femme du monde qu’elle quitta le cabinet qui venait de la dépouiller, faisant scintiller dans la lumière du jour sa dernière bague.
Si elle avait eu quelque bon sens elle aurait repéré l’assassin qui la guettait rue de Choiseul pour la soulager de sa pierre, mais vous l’aurez compris, Madame n’était pas douée pour le bon sens.
N’hésitez pas là aussi à donner votre avis, en commentaire. Les réponses constructives sont toujours intéressantes !
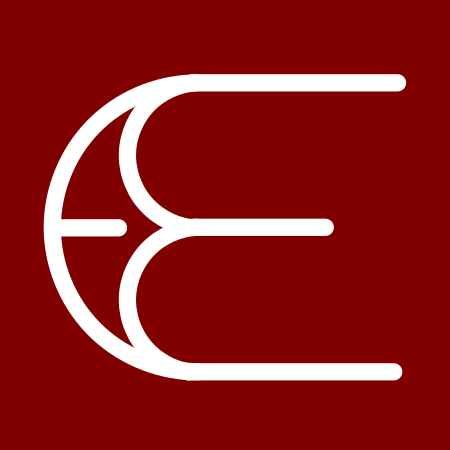



J’apprécie comme les mots choisis donnent sens à l’histoire. La fin aurait-elle été la même s’il n’y avait pas eu “duel” dans la sélection des mots fléchés?
Oui sans aucun doute. En fait choisir des mots c’est comme prendre un sentier. Même si je ne savais pas complètement comment j’allais les utiliser j’avais quand même une direction.
Quel régal que cette héroïne, sorte de Rastignac au féminin, esseulée parmi les plus tendres soieries et les plus accueillants des bras ! Il y a fort à parier que, même sans les mots imposés, votre nouvelle aurait été tout aussi alerte et savoureuse. Bravo !
Merci Élise. J’ai hâte de lire votre nouvelle.